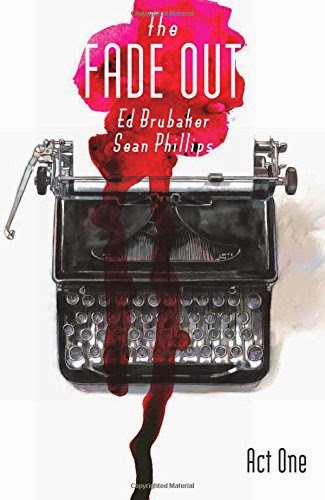Dans la liste désormais pléthorique des films des studios Marvel, c'est celui que personne n'attendait. "Une fois encore." est-on néanmoins aussitôt tenté d'ajouter. Il y a un an, la surprise était venue des Gardiens de la galaxie - un groupe de bras cassés, à l'époque inconnus non seulement du grand public mais même de la majorité des lecteurs de comics... et dont le membre le plus emblématique est un raton laveur parlant et sociopathe. Non exempt de défauts, le film de James Gunn emportait néanmoins la mise en faisant résolument le choix du divertissement décontracté, lorgnant éhontément vers les blockbusters des années 80 et se positionnant aux antipodes de l'approche sombre et "why so serious?" prévalant côté Warner/DC, tout en démontant assez subtilement au passage les clichés attendus du "récit d'origine" 1. Bilan : un jackpot au box-office, et une bascule réussie pour le désormais fameux MCU vers la dimension "cosmique" de l'univers de l'éditeur, indispensable à la poursuite des opérations sur grand écran dans les années à venir. Ant-Man, par bien des aspects, semblait pourtant partir de plus loin, et avec des objectifs moins clairs.
Si, sous leur forme moderne en tout cas, les Gardiens de la galaxie sont une création récente, Ant-Man, au contraire - apparu en 1959 sous la plume et les pinceaux de Stan Lee et Jack Kirby en personne, membre fondateur de la première mouture des Avengers en 1963 -, est un personnage établi de longue date dans le paysage Marvel... mais dans le fond du paysage, pour ainsi dire. Une situation au final presque pire que celle de ses devanciers sur grand écran de l'été dernier. Parce qu'un super-héros qui change de taille et communique télépathiquement avec les fourmis ne peut que laisser dubitatif (pour le dire poliment) tous les partisans d'une approche plus "adulte" et "réaliste" du genre. Parce qu'en tant que scientifique et qu'inventeur, Hank Pym, son premier et plus célèbre alter-ego au civil, fait figure de troisième roue du carrosse dans l'univers Marvel quand Reed Richards et Tony Stark sont occupés ailleurs. Parce que faute d'aucun récit véritablement majeur dont il soit le héros, l'évènement marquant que la plupart des lecteurs de comics retiennent de la carrière de Pym est qu'il a battu sa femme Janet - alias la super-héroïne la Guêpe (the Wasp) - dans un moment d'égarement du scénariste Bill Shooter au début des années 80, flétrissure que le personnage se traîne depuis comme une croix. Et, enfin, parce que Scott Lang, successeur de Pym sous le costume d'Ant-Man, n'a, jusqu'à ce jour, réussi qu'à être encore moins populaire que son prédécesseur 2.
Les choses s'annonçaient donc difficiles "sur le papier", et comme si cela ne suffisait pas, les interrogations se sont accumulées quant aux modalités de l'adaptation, et, incidemment, à sa place dans le développement de l'Univers Cinématographique Marvel.
Pourquoi clore la "phase 2" de celui-ci sur ce projet a priori incongru et dépourvu d'enjeux, plutôt que sur le très attendu et "massif" deuxième volet des Avengers : Age of Ultron - telle fut le première question à se poser. Puis, plus grave, vint le bad buzz consécutif à l'annonce du départ d'Edgar Wright, remplacé à la réalisation par l'anonyme yes-man Peyton Reed. Wright, connu notamment pour son excellente "comédie romantique avec des zombies" Shaun of the Dead, était l'initiateur de cette adaptation et portait le projet à bout de bras depuis 2006. Lorsqu'il claqua la porte, affirmant ne plus reconnaître son œuvre au fil des réécritures du scénario, la communauté geek et les cercles de bon ton cinéphile se retrouvèrent à marcher main dans la main sur les autoroutes de l'information, pour déplorer de concert la façon dont les studios Marvel se détournaient des "auteurs" au profit de simples "faiseurs" supposément sans âme, livrant des produits calibrés sans aspérité ni identité 3.
Enfin, les différentes bandes-annonces délivrées depuis janvier par les studios donnaient assez nettement l'impression que ceux-ci ne savaient pas trop comment vendre un tel produit... Bref, sans aller jusqu'à crier qu'on courait à la catastrophe, les raisons ne manquaient pas d'attendre avec circonspection, ou, tout simplement, désintérêt, ce nouveau film.
Lequel - on me signale dans l'oreillette qu'il serait peut-être temps de le dire - s'avère, au final, une réussite de bout en bout, et même, serais-je fortement tenté de déclarer, tout simplement l'une des tous meilleures adaptations à ce jour sorties des studios Marvel. Soyons clairs : il ne s'agit ici nullement de crier au chef-d'œuvre du Septième Art, Peyton Reed ne s'est pas révélé brusquement un digne émule de Stanley Kubrick. On est ici, à nouveau, dans le cadre d'un blockbuster de pur divertissement, sans aucune autre ambition - mais à cette nuance après que dans son genre, le résultat cette fois flirte avec le sans faute. Comment ses créateurs en sont-ils arrivés là ?
D'abord en assumant sans rougir le postulat what the fuck du projet. Les bandes-annonces déjà citées s'assaisonnaient d'un second degré dépréciatif ("Il est trop tard pour changer le nom ?", "Je sais... ce n'est pas moi qui ai choisi..."), aux allures de tentative forcée de mettre les rieurs de son côté. Ces scènes sont tout simplement absentes du montage final. Dans un Univers Cinématographique Marvel où les éléments les plus bizarres de sa source de papier se voient de plus en plus offrir droit de cité, le concept d'Ant-Man n'est, pour ainsi dire, à prendre ni moins... ni plus au sérieux que le reste. Sans fausse honte, le film déroule de bout en bout, et de façon réjouissante, son programme d'homme qui court avec les fourmis ou livre de titanesques batailles à coups de maquette de locomotive.
En dépit du départ d'Edgar Wright, son influence demeure bien présente et Ant-Man fait la part belle à un humour anglais non-sensique (flirtant par moments avec le Doctor Who-esque), auquel vient se mêler une veine plus américaine, marquée par le stand-up ainsi que l'école Apatow, par le biais de l'implication au scénario d'Adam McKay et de Paul Rudd, l'interprète du rôle-titre, lui-même. Cette forte présence de l'humour et ce mélange des traditions comiques est l'une des grandes réussites du film, n'hésitant pas à faire rire aux éclats sans que cela se fasse, comme on pouvait le craindre, à l'encontre du film lui-même, ni que cela nuise, par ailleurs, à son efficacité en tant que film de super-héros. Sur ce point, du reste, les changements d'échelle permanents de Scott Lang fournissent par ailleurs le prétexte à des scènes d'action inventives, tout en restant en permanence lisibles - deux éléments qui relèvent chacun du luxe dans le paysage des blockbusters actuels.
Si Ant-Man n'apparaît pas totalement déconnecté du MCU (comme le souhaitait Edgar Wright), il s'y adosse intelligemment sans paraître écrasé sous son poids. S'il se murmure que certains concepts faisant leur apparition dans le film pourraient jouer un rôle crucial dans les films à venir, cette introduction se fait par la bande sans donner l'impression de prendre en otage le spectateur, qui a tout loisir d'ignorer cet aspect des choses. En contrepartie, l'intrigue s'appuie sur l'existence d'un univers pré-établi pour donner de l'épaisseur à ses personnages et à leurs aventures. Ainsi, Scott Lang apparaît bien dans le film comme un potentiel héros "de deuxième génération", appelé à reprendre le flambeau d'un Hank Pym ayant officié pour le compte du S.H.I.E.L.D. plusieurs décennies plus tôt en tant que premier Ant-Man, aux côtés de sa femme et jusqu'à la disparition de celle-ci. Cette approche déplace les enjeux du "récit d'origine" juste assez pour donner au genre une impression de fraîcheur, tandis que des personnages connus font quelques caméos qui apportent au film... sans qu'ils y apportent avec eux pour autant tout un poids d'enjeux développés ailleurs.
Ajoutons pour conclure que Paul Rudd (Scott Lang) et Michael Douglas (Hank Pym) semblent beaucoup s'amuser, et de façon communicative, dans leurs rôles, qu'Evangeline Lilly en fille du second tire son épingle du jeu et impose son importance dans ce qui reste, par ailleurs (il faut bien l'avouer), un "film de mecs" (disons qu'on est très, très loin des critères du test de Bechdel...), et que Corey Stroll ne se débrouille pas trop mal dans un rôle de méchant de service qui, sans être extraordinairement développé, tient tout de même un peu plus la route que la plupart de ses prédécesseurs 4. Non, Ant-Man n'est peut-être pas un chef d'œuvre (on n'en demandait de toute façon pas tant), mais au rayon des divertissements estivaux, sans prise de tête mais non sans qualité, il remplit parfaitement un programme pas si évident que ça - à en juger par le caractère plutôt exceptionnel des réussites en la matière. Et confirme au passage, s'il en était besoin, qu'en matière de super-héros sur grand écran, les studios Marvel ne sont pas près de perdre la position dominante qu'ils ont su bâtir et conserver ces dernières années.
1 Chaque tentative d'un personnage de régler son "traumatisme fondateur" désormais de rigueur dans ce type de productions, s'avérant un échec calamiteux et une mise en péril de l'équipe. On verra plus loin comment Ant-Man joue lui aussi, mais différemment, avec le caractère désormais canonique (et trop souvent bien ennuyeux) de ce type de récit.↩
2 Par souci de clarté, je laisse de côté le troisième porteur du costume d'Ant-Man, Eric O'Grady, anti-héros comique de la mini-série The Irredeemable Ant-Man (L'Incorrigible Ant-Man en VF chez Panini) de Robert Kirkman et Phil Hester.↩
3 J'ouvre ici une parenthèse plus longue. Les noms de Tim Burton, de Sam Raimi et de Christopher Nolan revenaient comme des mantras dans ces invocations. J'eus même la surprise d'entendre une fois citer en exemple Zack Snyder, ce qui témoigne tout de même, et d'un certain aveuglement sur la qualité de sa production, et d'une torsion certaine du concept d' "auteur". C'était oublier miséricordieusement - ou opportunément - le Hulk absolument calamiteux d'Ang Lee, le Thor plutôt décevant de Kenneth Brannagh (auquel on me permettra de préférer très largement le second volet, The Dark World, par l'anonyme Alan Taylor), ou l'Iron Man 3 de Shane Black. Traité lui-même comme un tâcheron sorti de nulle part, à son arrivée dans l'univers Marvel, par certains cercles "cinéphiliques" qui ignoraient tout de son statut véritablement culte par ailleurs, Joss Whedon semble avoir eu sa part dans le choix de mettre en avant pour le MCU des artisans qui, à défaut d'être géniaux ou visionnaires, se sont révélés plutôt solides, et n'ont pas démérité face à certains noms plus prestigieux mais moins inspirés par le genre.↩
4 Si l'on s'en tient au fameux adage hitchcockien selon lequel meilleur est le méchant, meilleur est le film, il faut bien avouer que les productions des studios Marvel trouvent souvent là l'une de leurs limites. Les Gardiens de la galaxie, de ce point de vue, touchaient le fond en sacrifiant totalement le personnage de Ronan, autrement plus intéressant, riche et complexe dans ses développements de papier que le bouffon manichéen et incapable qui nous était donné à voir à l'écran.↩
 Ant-Man
Ant-Man
Réalisé par : Peyton Reed.
Scénario : Joe Cornish, Adam McKay, Paul Rudd, Edgar Wright.
Avec : Paul Rudd (Scott Lang / Ant-Man II), Evangeline Lilly (Hope Pym), Michael Douglas (Hank Pym / Ant-Man I), Corey Stroll (Darren Cross / Yellowjacket), Michael Peña (Luis).
Sortie en salle : Juin / juillet 2015 (USA / France).